Jean-Bertrand Pontalis
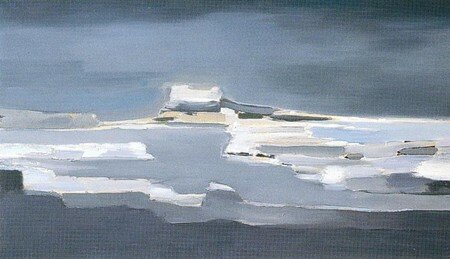
J'ai été, pendant quelque
temps, professeur. J'aimais ce métier. J'avais, à quelques années près l'âge de
mes élèves. Était-ce ce faible écart qui me rendait aimable, aisé, l'exercice
de la parole, lui permettant de n'être ni autoritaire ni balbutiante ? Était-ce
quelque identification lointaine à mes illustres prédécesseurs — Alain,
Bergson... — , ces professeurs que la République et leur vertu propre
déléguaient dans les provinces pour que les fils aux blouses grises
d'instituteurs et d'épiciers, les puînés des paysans (l'aîné, attaché de force
à la terre, reprendrait la ferme) soient initiés à la rhétorique et à la
philosophie au même titre que les Parisiens bien nés ?
Le fait est que je prenais un égal plaisir à acheter, une fois mes cours
terminés, primeurs et brugnons, figues et poulpes sur le grand mail face au
Lycée Masséna et à expliquer aux jeunes Niçois, enclins à la douceur de vivre
et à des trafics pas toujours innocents, la rigueur de l'impératif catégorique
ou les ruses infinies du malin génie.
Seulement mon malin génie à moi, d'autant plus retors qu'il n'avait pas les
traits d'un diable, me rendait inaccessible tout impératif, même hypothétique.
Si j'enseignais en me jouant, c'est qu'enseigner m'était un jeu dont je me
faisais fort de transmettre les règles élémentaires et d'indiquer les coups
qui, avec un rien d'astuce ou de talent, garantissaient le succès.
Le succès, c'est-à-dire la maîtrise verbale d'à peu près n'importe quoi, la
référence au « concret » — « prenons ce morceau de craie » — venant toujours à
point nommé nous assurer, mon auditoire et moi, que nous ne nous dissolvions
pas dans les nuées.
J'y mettais de la
conviction. J'étais à mon affaire.
Une fois, un de mes
élèves me dit, alors que nous sortions de la salle de classe : « Intéressants
vos cours mais quelque chose me gêne. » J'attendais une demande
d'éclaircissement : peut-être étais-je passé un peu vite la semaine précédente
sur la loi des trois états ou avais-je pris trop de plaisir, ce jour-là, à
élucider le paradoxe du menteur. « Oui, quoi ? — J'ai l'impression que vous n'y
croyez pas. » J'encaissai. Mais je me repris vite : il devait être chrétien,
celui-là, il lui fallait des assurances, une règle de vie, un garant de la
Vérité et de l'Amour pour tenter d'échapper aux troubles de son âge. J'avais
connu cela ! Je me sentis soudain beaucoup plus vieux que lui et ses camarades.
Pourtant, par devers moi, je lui donnais raison, je lui donne encore raison
aujourd'hui.
Il avait sans conteste
visé juste. Si j'ai même renoncé par la suite à être professeur, peut-être ce
garçon anonyme y est-il pour quelque chose.
« Vous n'y croyez pas. » Ce jour-là, je rentrai chez moi peu fier, sans avoir
même l'envie de flâner au marché. Depuis j'ai tenté de transformer le reproche
en titre de gloire. Tout me détourne de la croyance, de l'adhésion à une cause,
à une doctrine, à un discours qui prétend dicter ses lois, faire autorité, le
discours politique n'étant que le modèle du genre.
Je tiens pour suspecte une pensée qui, tout en s'en défendant, a réponse à
tout et tient à l'écart sa propre incertitude. Au cœur de cette réticence, je
trouve le refus d'identifier un langage à la vérité. Cependant, comme tout un
chacun, j'ai besoin d'évidences.
Quelle joie quand elles s'imposent, quand rien ne peut les altérer !
Dans les gestes de l'amour (parfois), dans la course d'un enfant, où qu'il
aille, dans la soif qui s'apaise à l'instant. Faut-il donc que le corps
intervienne, qu'il soit là, à l'origine et à la fin du mouvement, et que
l'évidence s'estompe dès que commence la pensée ?
Pourtant, pas plus que la croyance, le flou ne me retient. Il ne m'attire que
pour me dégager du trop défini, du classé, de la tyrannie des codes.
Ce moment où, bien qu'on
se soit toujours gardé de croire, on s'afflige de ne pas croire, ce vacillement
dont on craint que, de proche en proche, il ne vous fasse, la faille une fois
décelée puis ouverte, tomber dans le trou, je le connais aussi bien aujourd'hui
dans la psychanalyse qu'autrefois avec l'enseignement. Je ne cherche pas à
m'en protéger. Je l'accueille plutôt comme un signe de bon augure. C'est que,
n'étant pas annoncé par l'ennui, il n'annonce pas non plus quelque
généralisation de l'« à quoi bon ? ».
Je ne puis me le représenter que comme un creux et, ce creux, je le situe dans
le langage même. Quand le langage en vient à s'ériger en maître absolu, à
ignorer de quoi il est l'héritier — d'une succession de morts et de meurtres
— quand il méconnaît que sa lumière apparente
n'est qu'une ombre portée, alors le « creux » vient le lui rappeler. S'il
oublie la perte qui est en lui, alors il faut le perdre, lui, l'abandonner à
son arrogance. Quand nous le retrouverons, il ne s'écoutera plus parler tout
seul, il se souviendra de son absence, grâce à la nôtre ; peut-être lui
aurons-nous, à notre tour, manqué.
D'où vient le pouvoir des
mots dans l'analyse ? De leur mouvement. Il est rare que ce pouvoir résulte
d'une construction complexe, de l'ingéniosité d'une hypothèse, exclu qu'il
passe par des termes savants ou une docte explication. Mais qu'à un certain
moment les mots manquent, à l'un ou à l'autre, et c'est de ce creux, de cette
dénivellation légère qui fait trébucher une activité verbale jusqu'alors
assurée, que peut se dire, dans le défaut de langue, ce qui a fait défaut comme
ce qui a, illusoirement, comblé : par exemple le visage d'une mère, sous la
lampe, occupée à sa couture, tandis qu'on jouait non loin d'elle aux dominos.
«Parler avec des mots à moi », disent-ils un jour ou l'autre, fatigués de tant
de paroles ingérées, empruntées, incrustées dans leur chair. La revendication
est absurde, ils le savent : les mots sont « partie commune » comme l'indiquent
les règlements de copropriété.
Pourtant il faut qu'il vienne, à son heure, ce voeu impossible, dans le
fléchissement de l'heure creuse, celui où l'emploi du temps et des mots, où la
distribution de l'espace basculent. Quand les mots manquent, c'est qu'à son
insu on s'apprête à toucher un autre sol.
La clairière qui se découvre soudain au creux de la forêt trop dense,
étouffante, où le silence est menace ; le haut plateau qui déploie sa large
surface au creux des montagnes dont le relief apparaît alors furieusement
morbide, crispé ; la mer, mais il me faut des vagues ; les blancs et les marges
dans la page, les lacunes de mémoire et le creux des reins ; le ciel breton, sa
lumière mobile qui rend à la terre ses courbes ; la bêtise qui vous laisse sans
une idée, la tête creuse, et la beauté qui, vous sidérant, vous fait
réceptacle, vous donne pour un instant une âme (que je me représente comme une
ellipse, peut-on imaginer une âme carrée, rectangulaire ?) ; une parenthèse ;
la coquille du Campo de Sienne ; un jardin en contrebas ; cette femme que
j'étreins et que seul
Les creux sont la respiration de ma vie. La mort, elle, est un trou.
Nicolas de Staël, "Le fort carré d'Antibes", 1955

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F2%2F226948.jpg)


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F97%2F19%2F264038%2F54615984_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F58%2F58%2F264038%2F51933999_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F00%2F14%2F264038%2F51702609_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F32%2F264038%2F51501830_o.jpg)